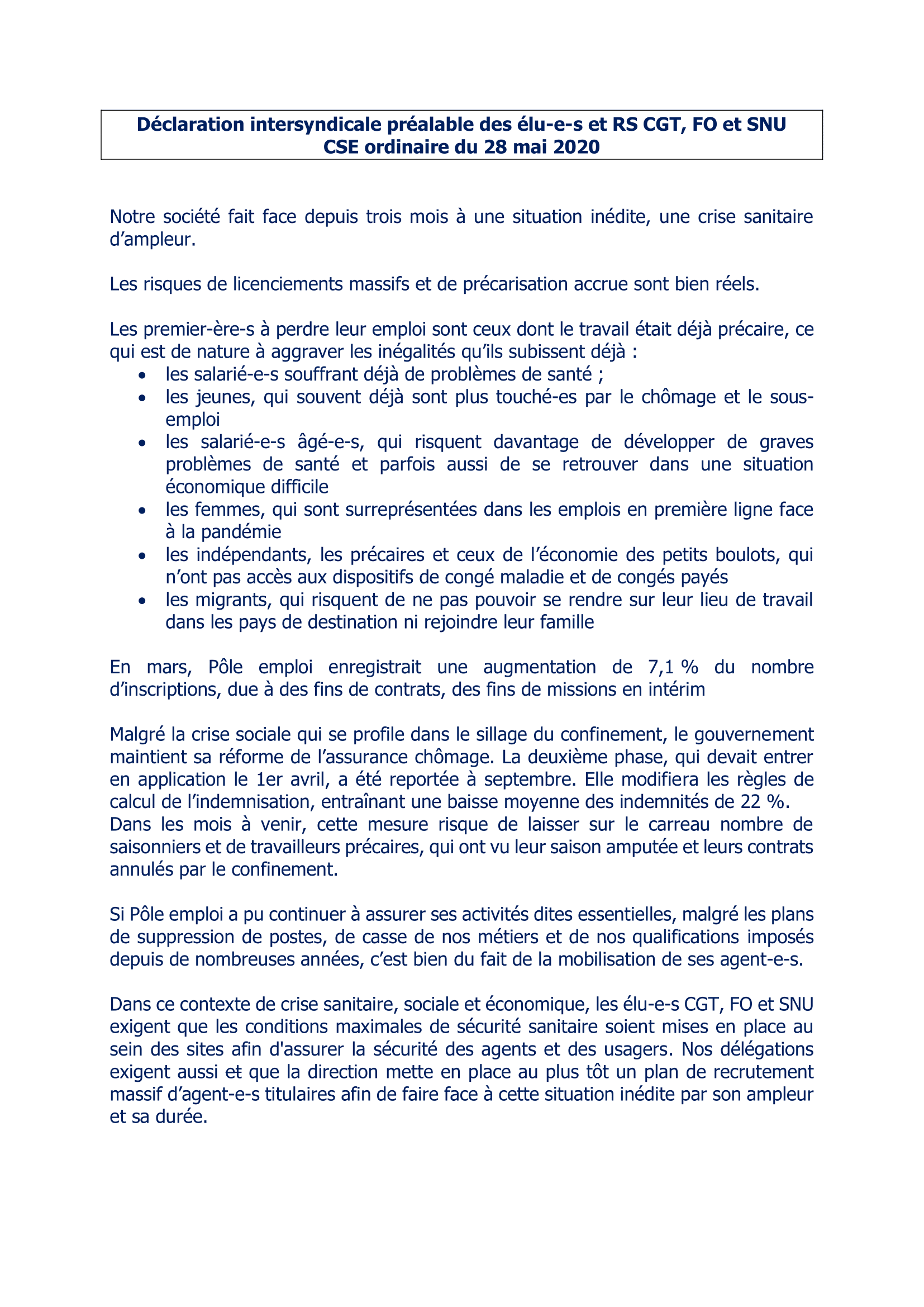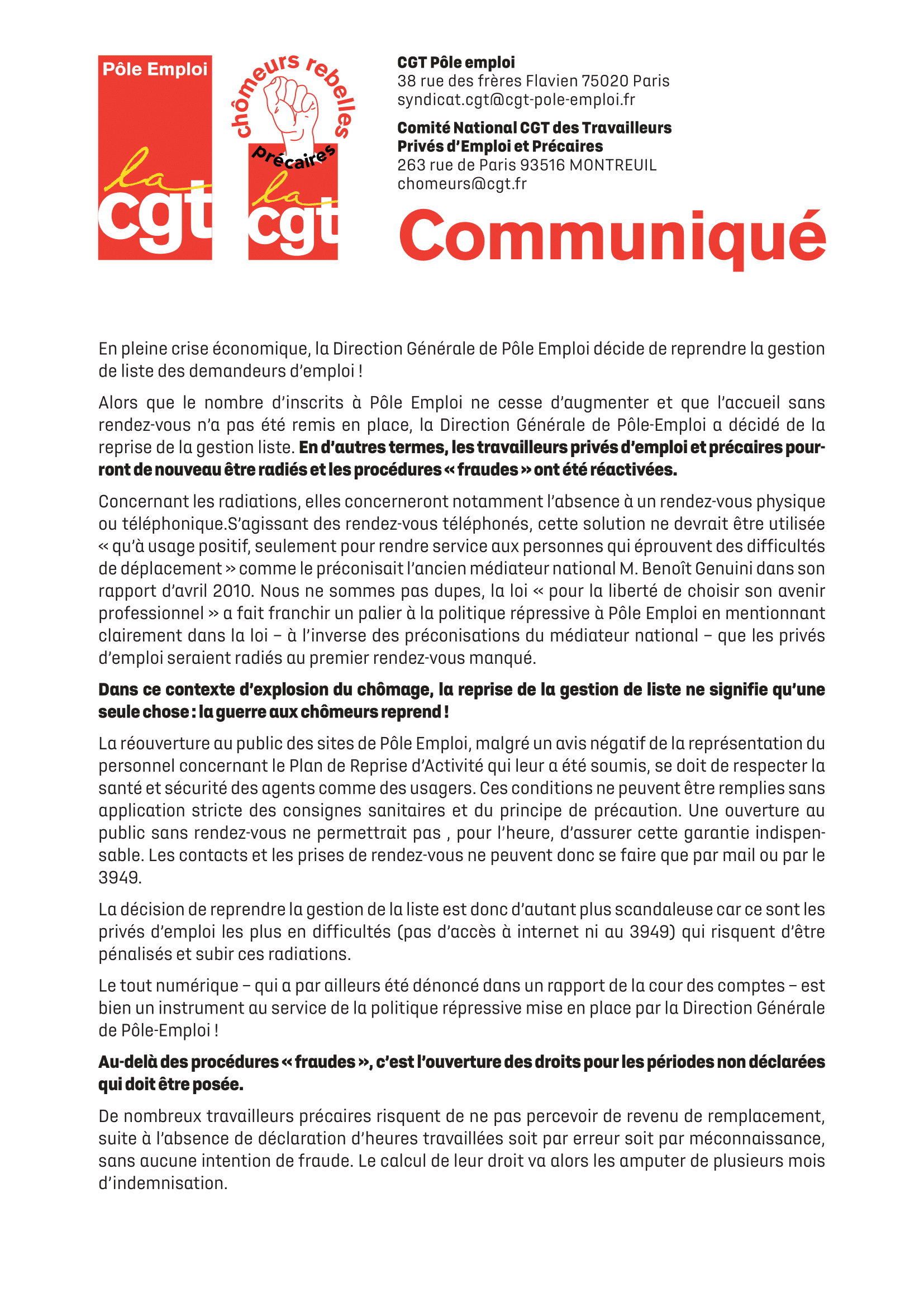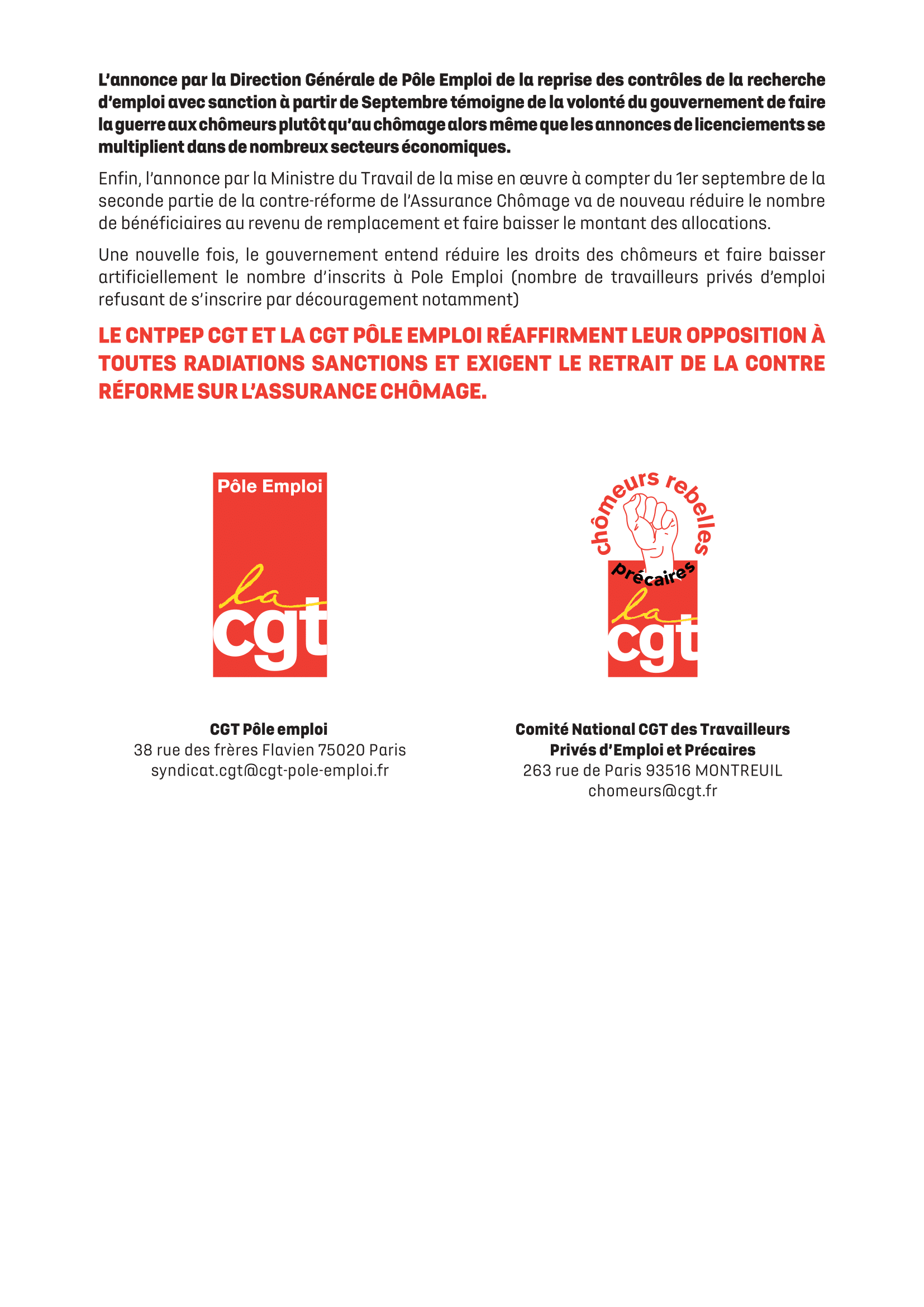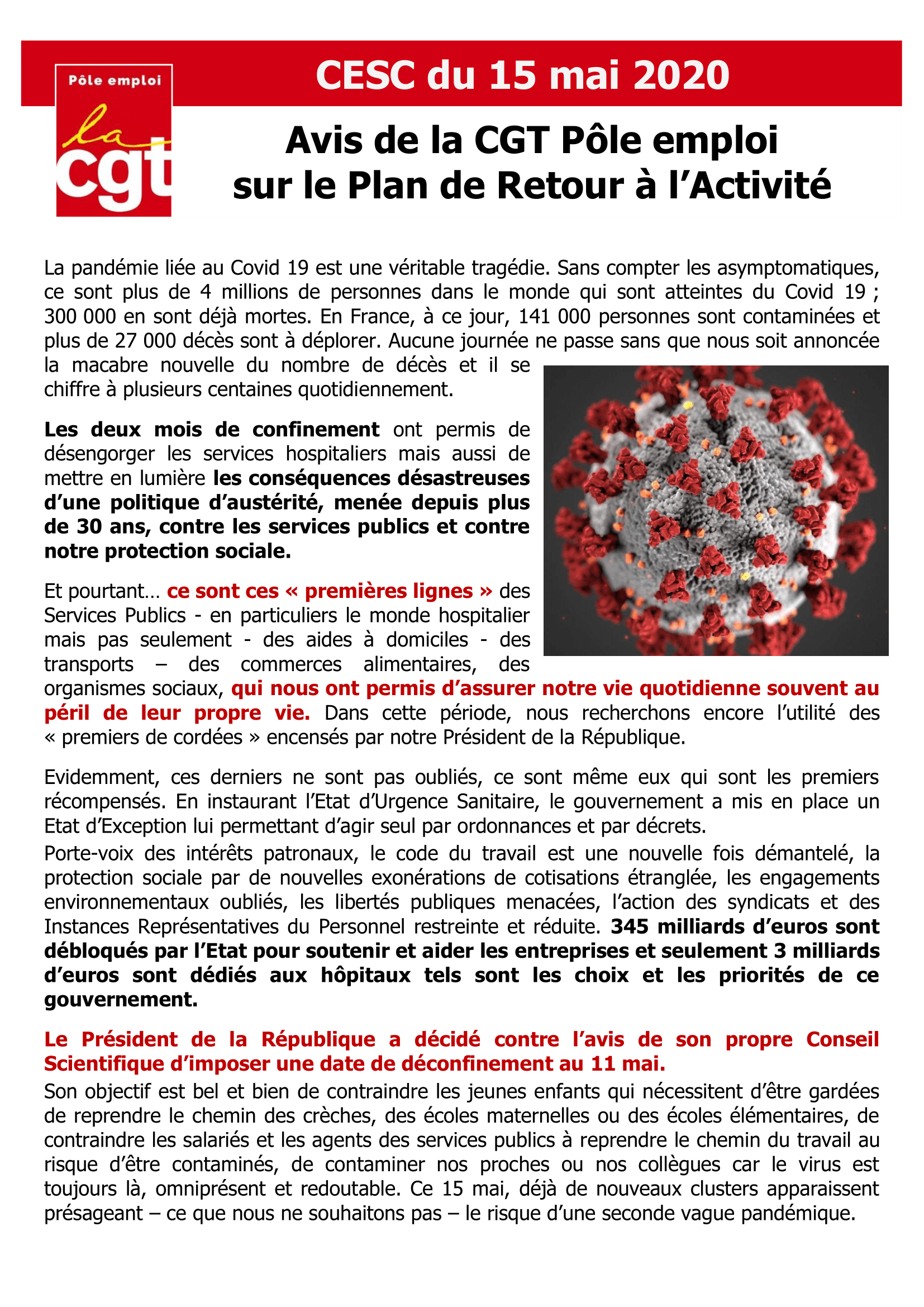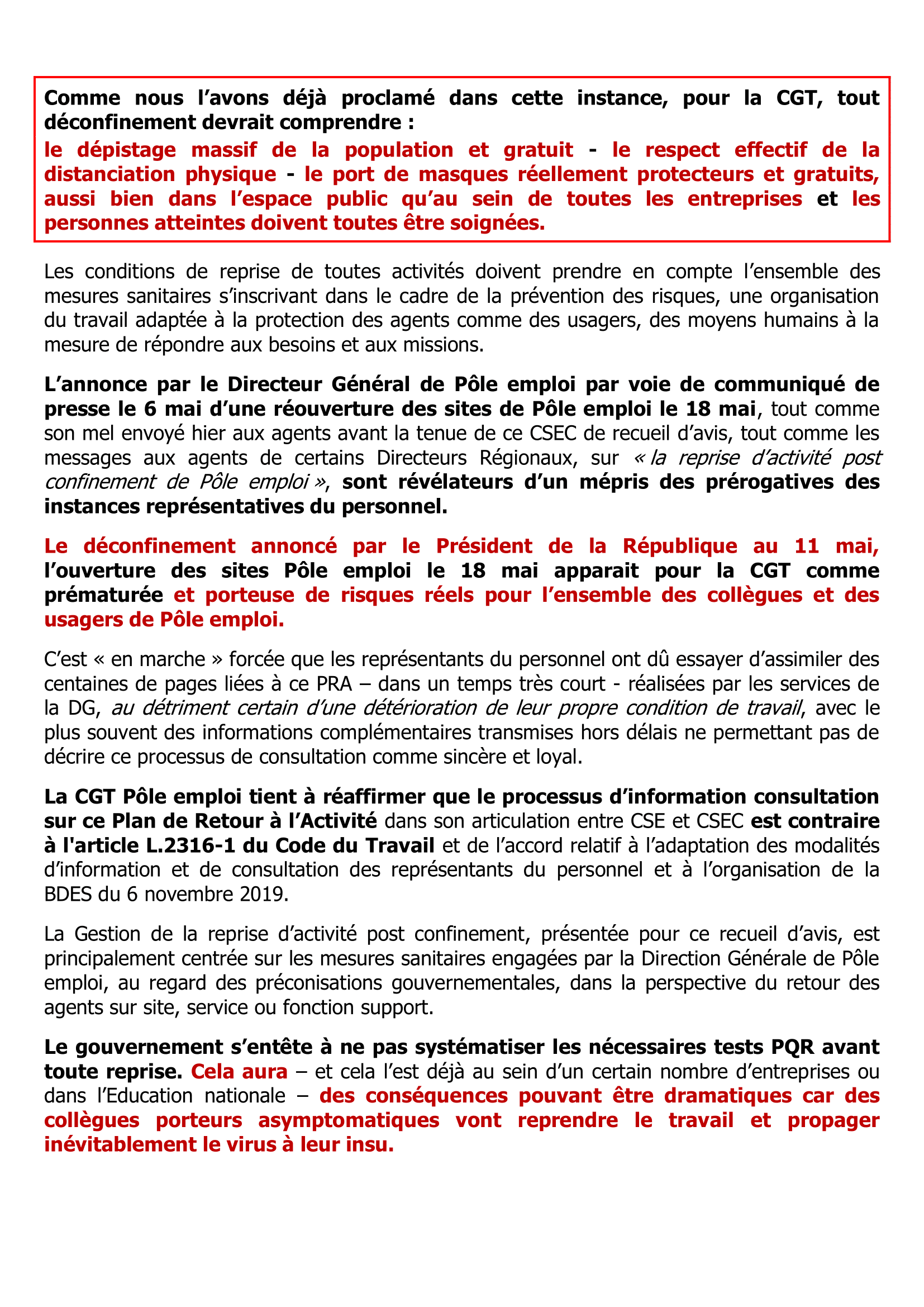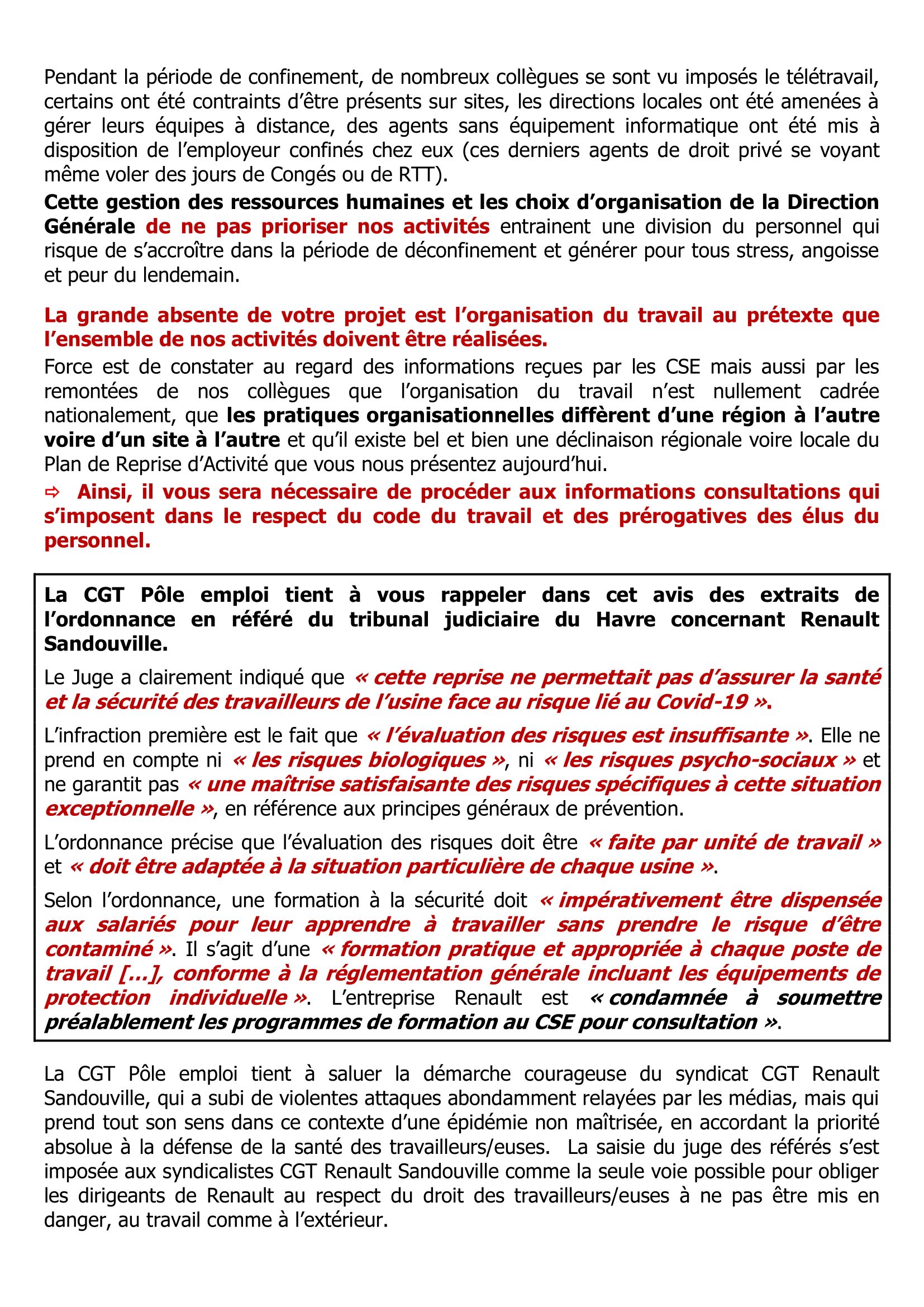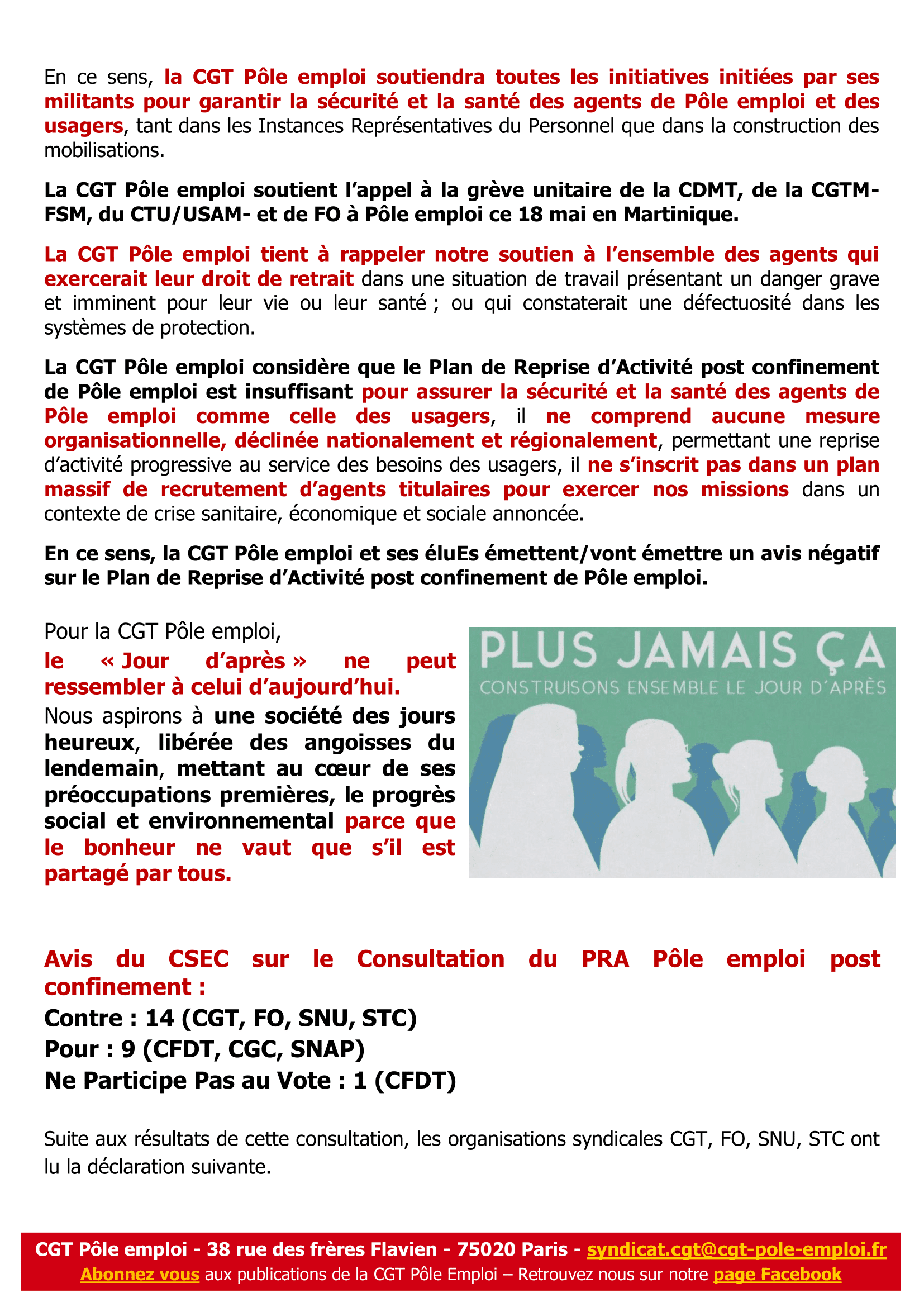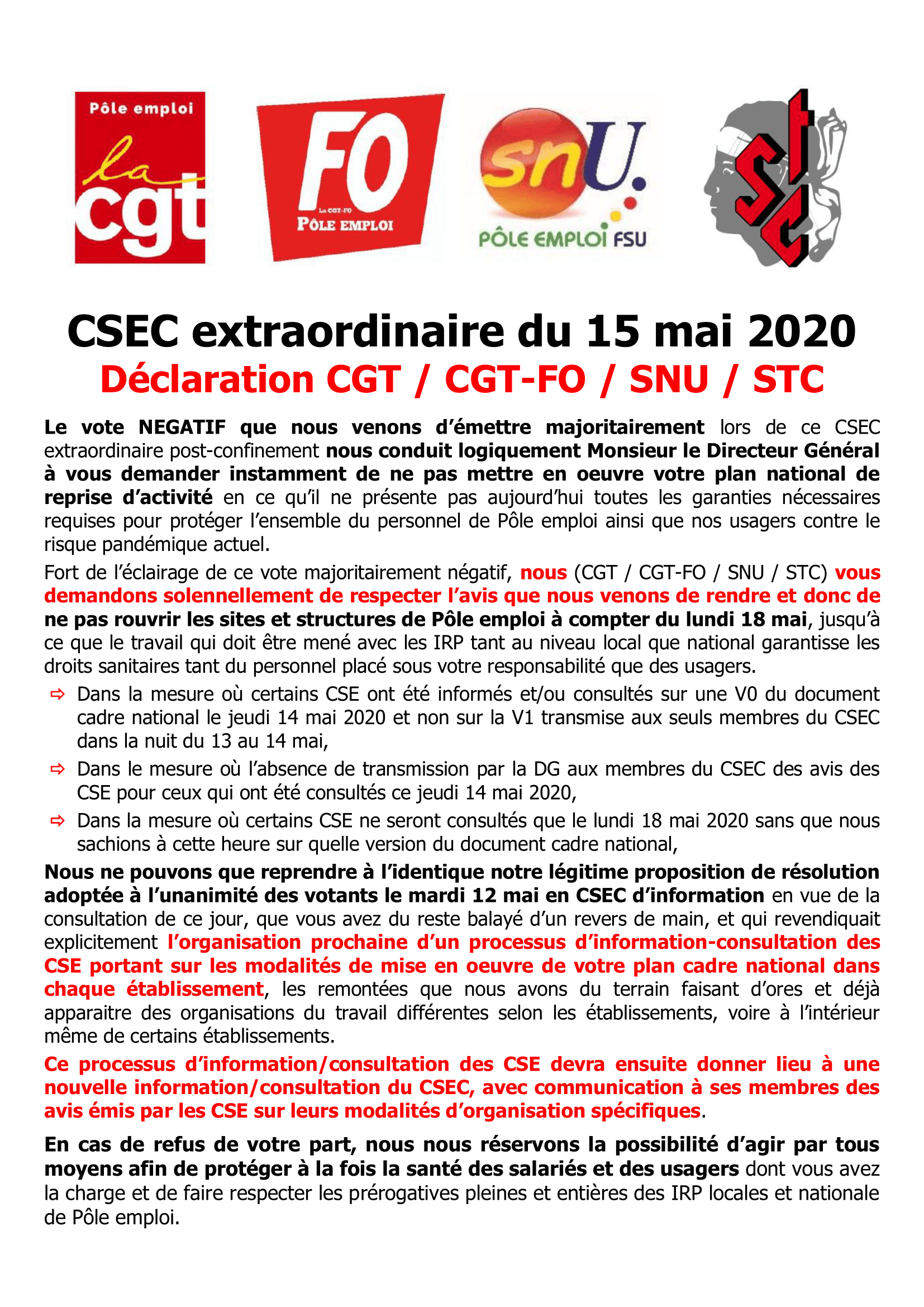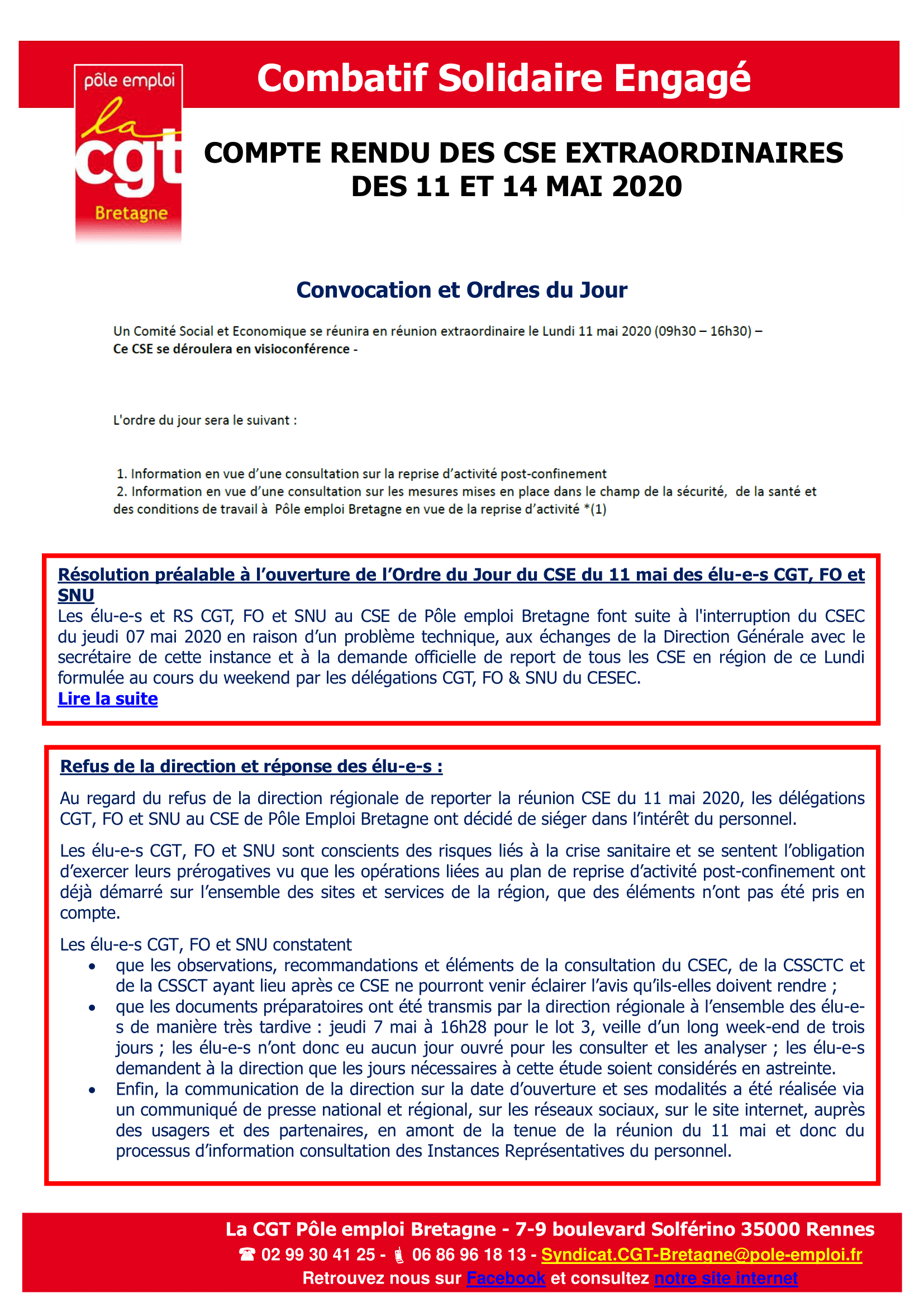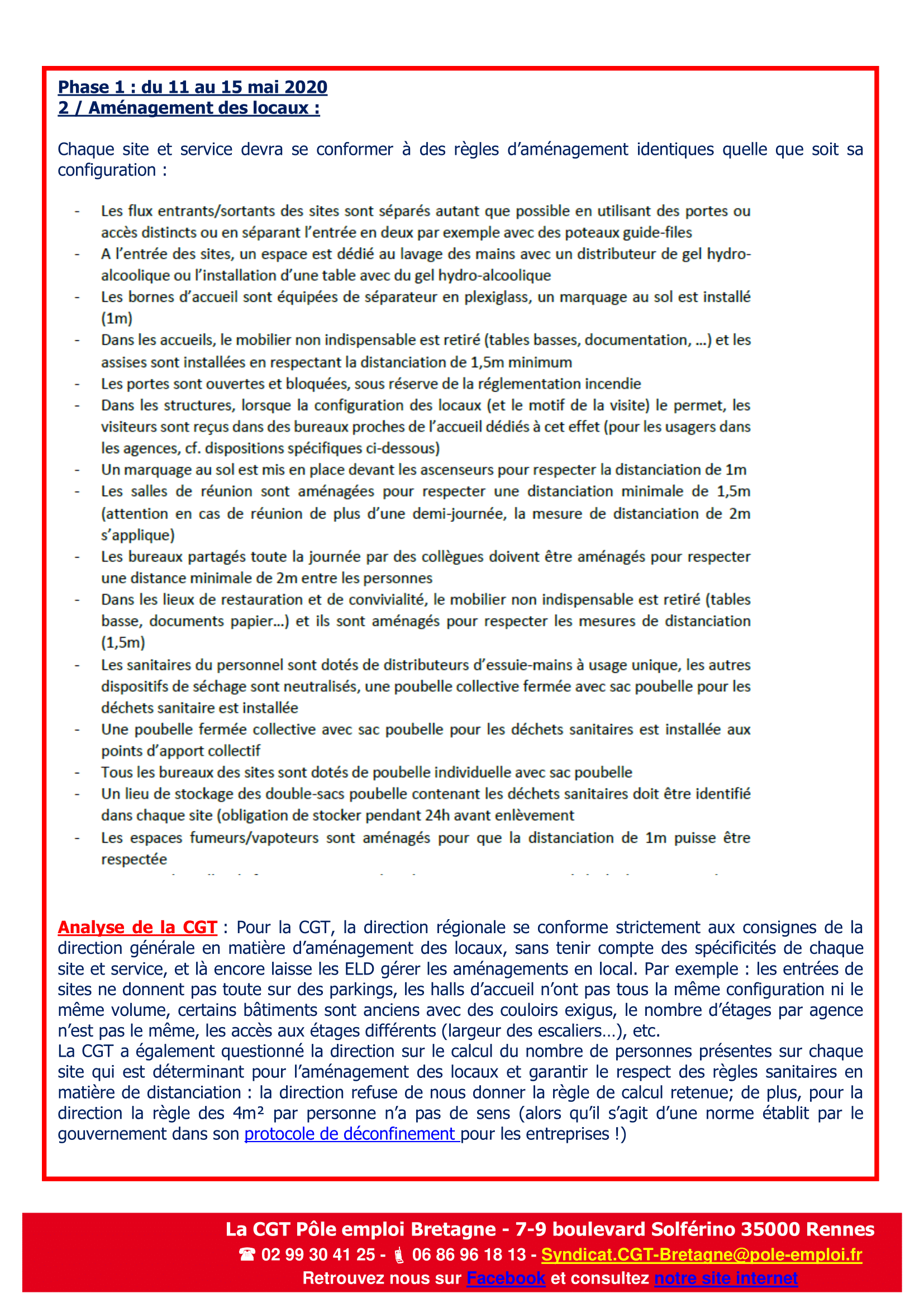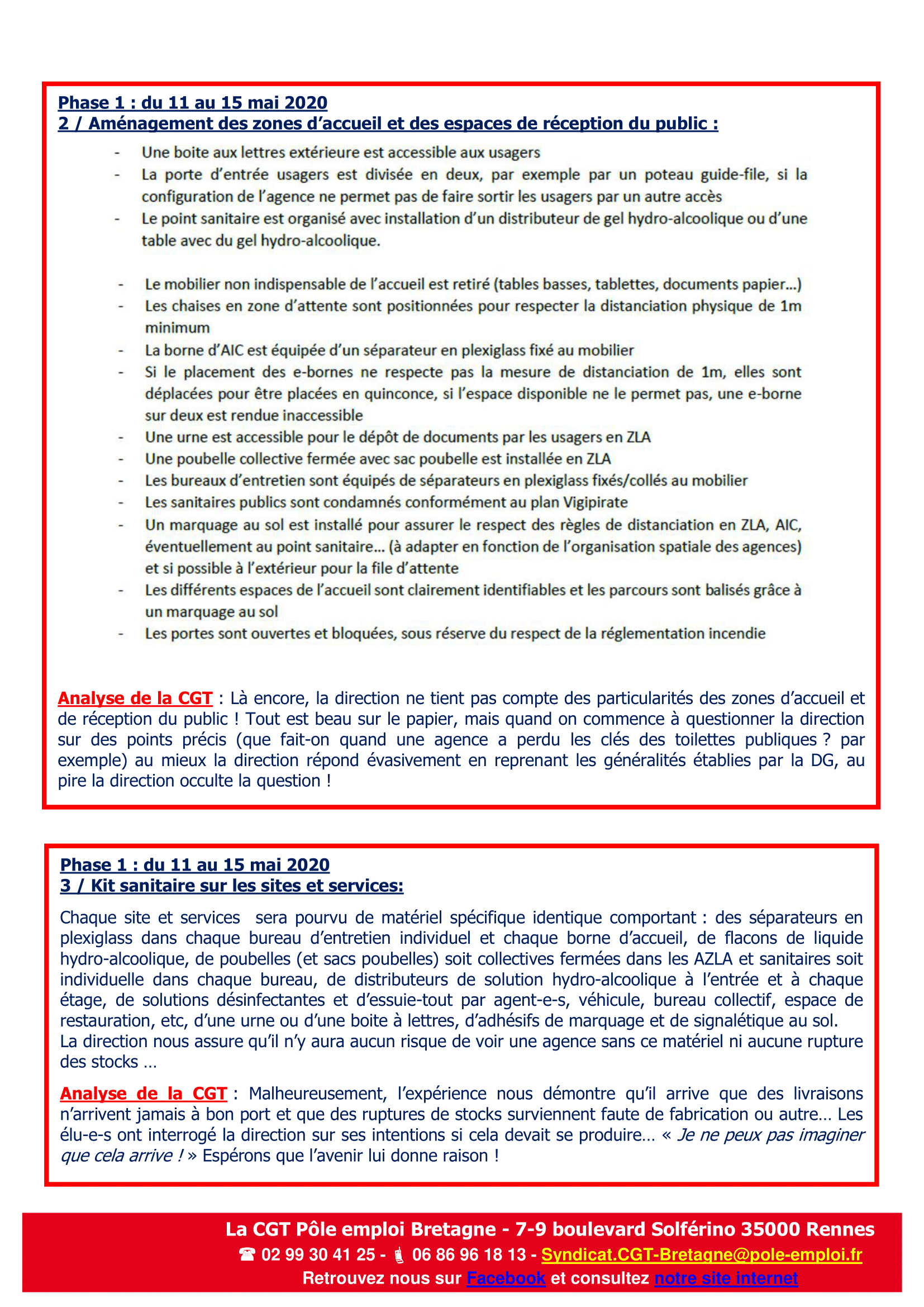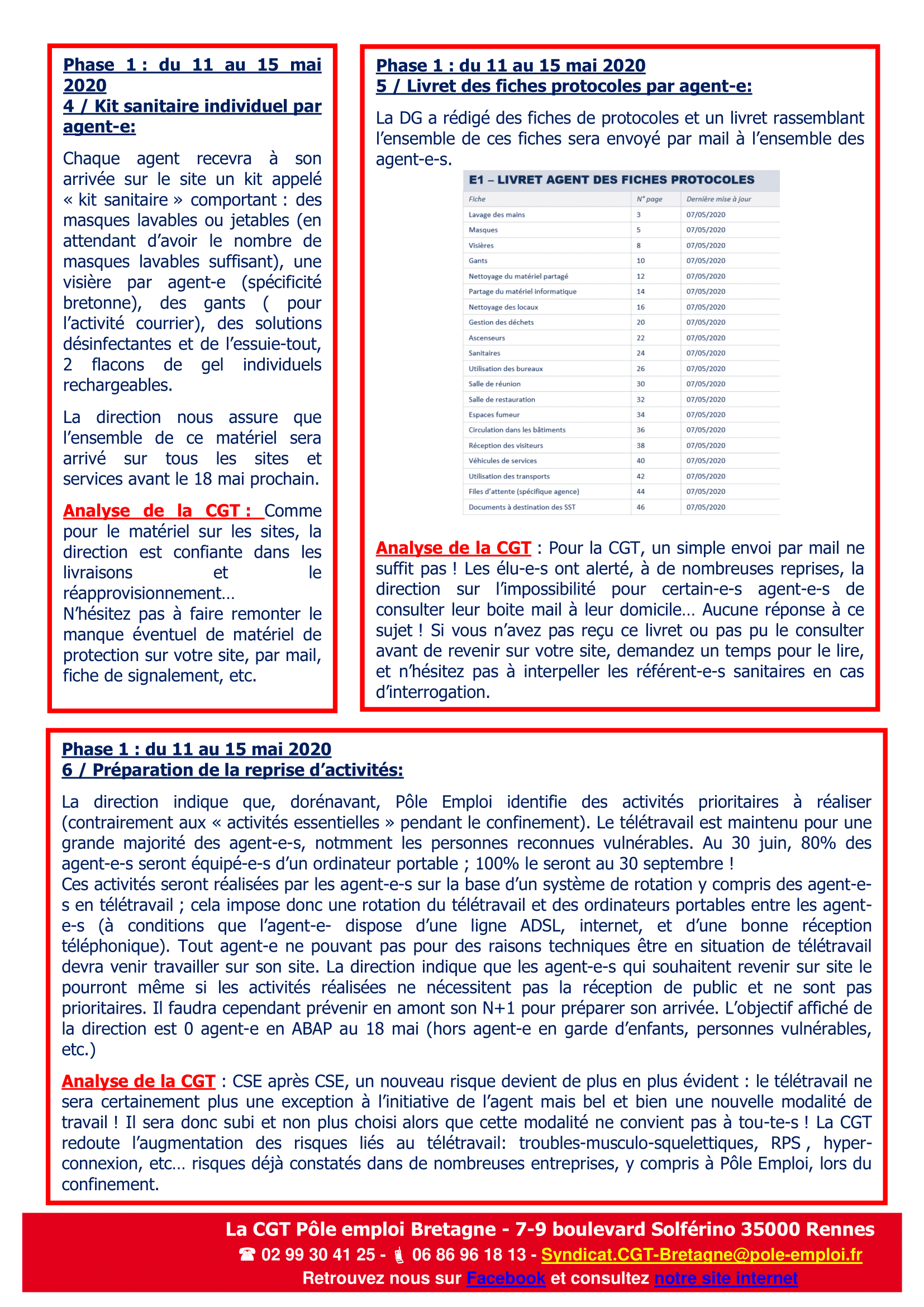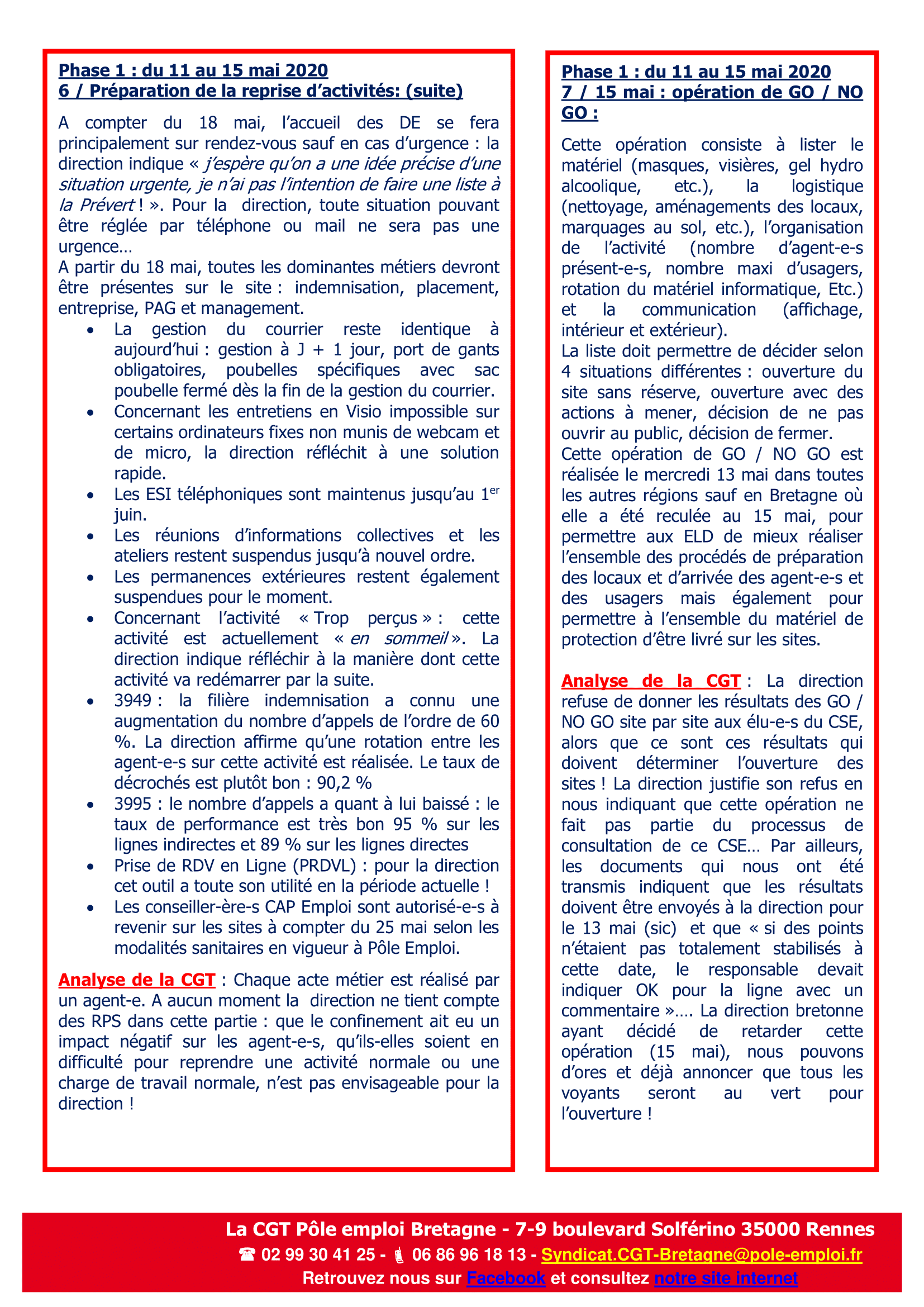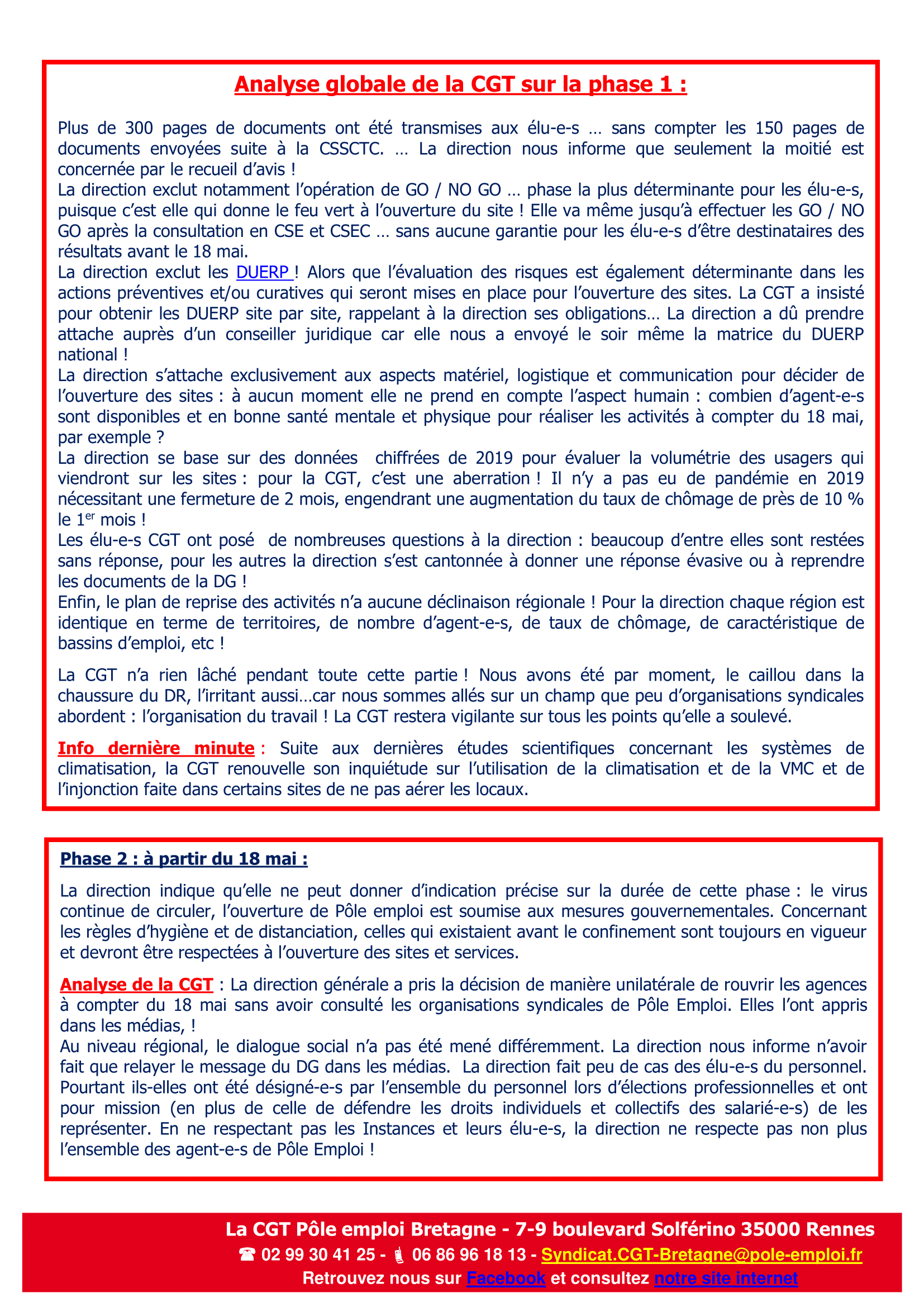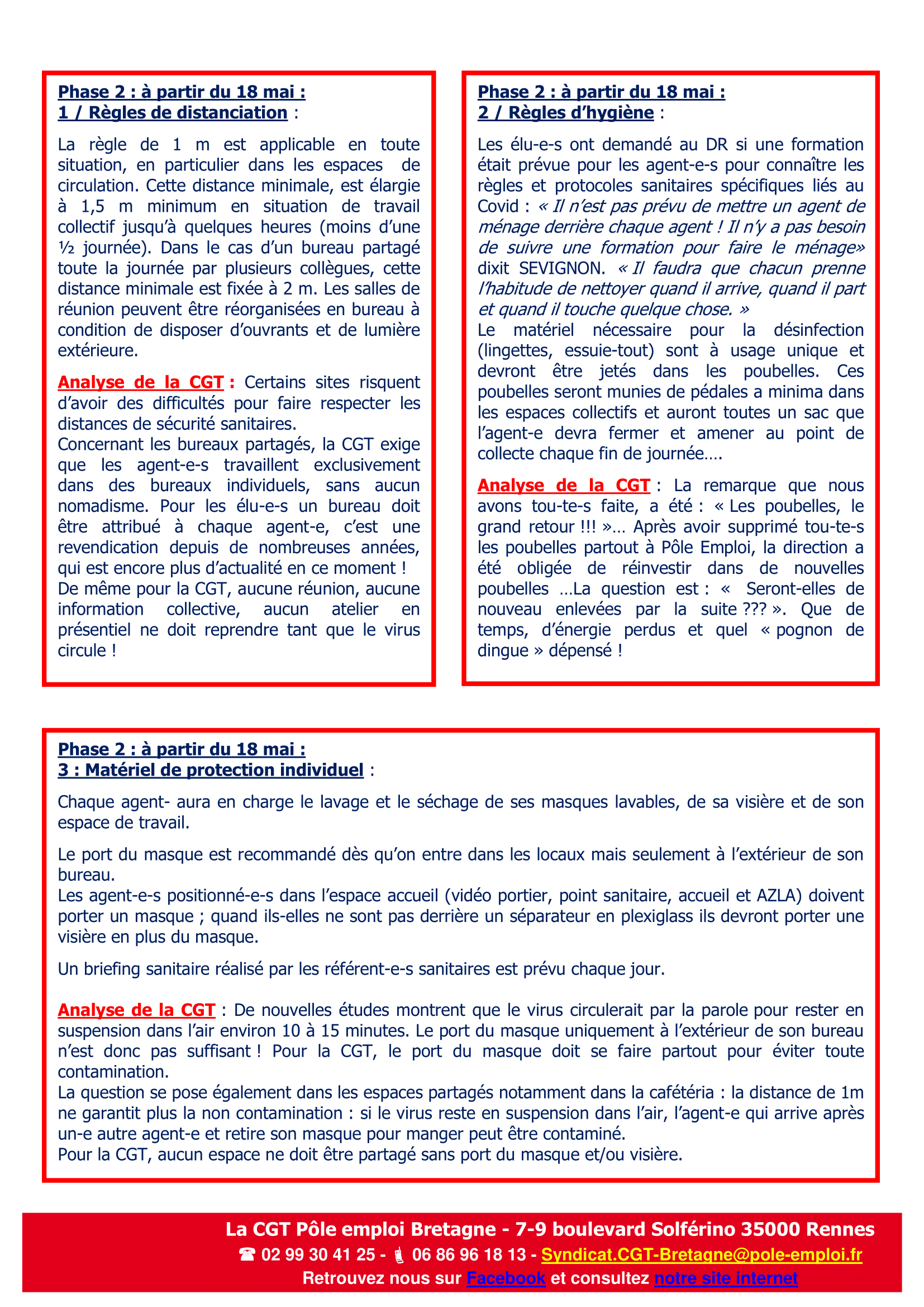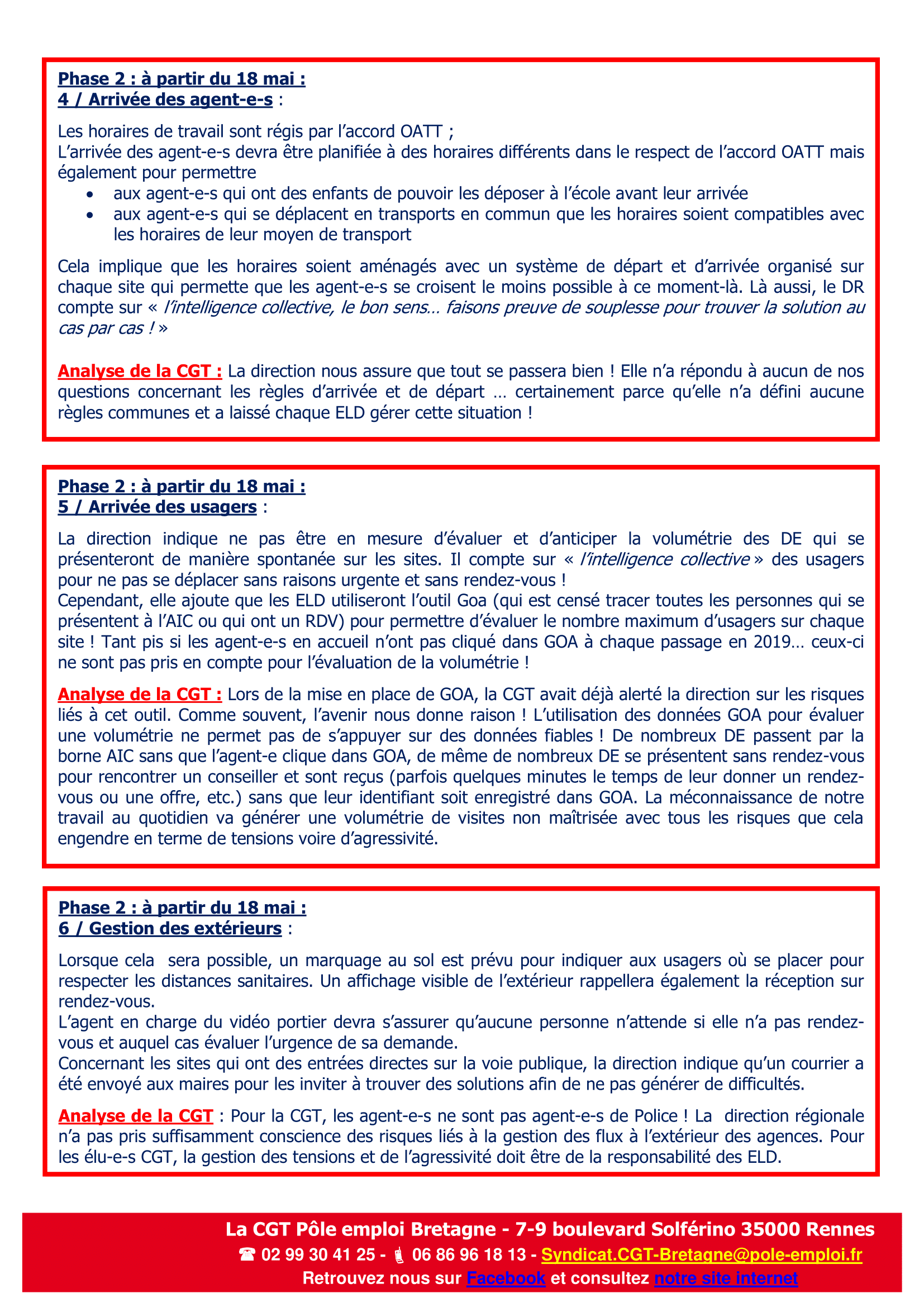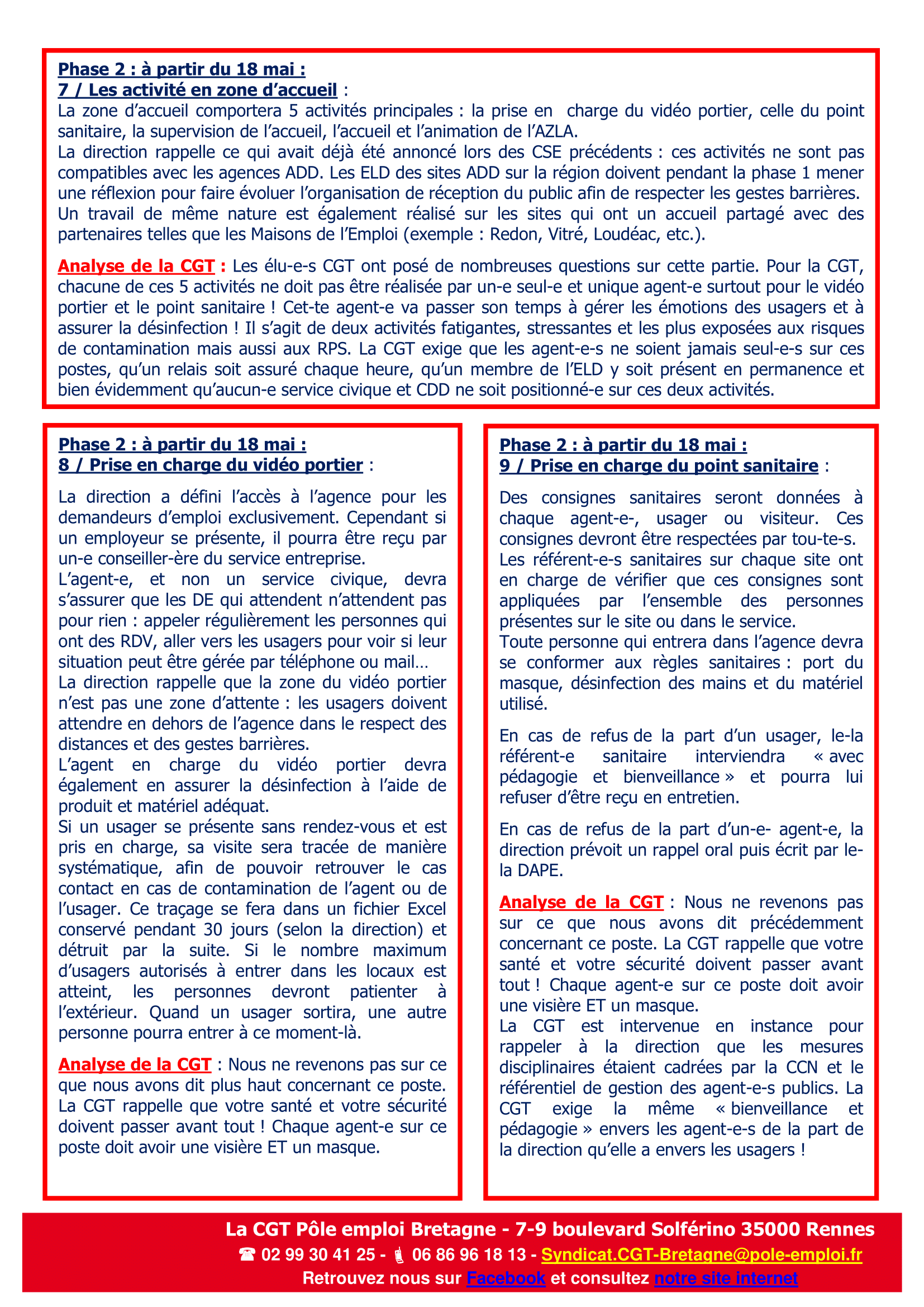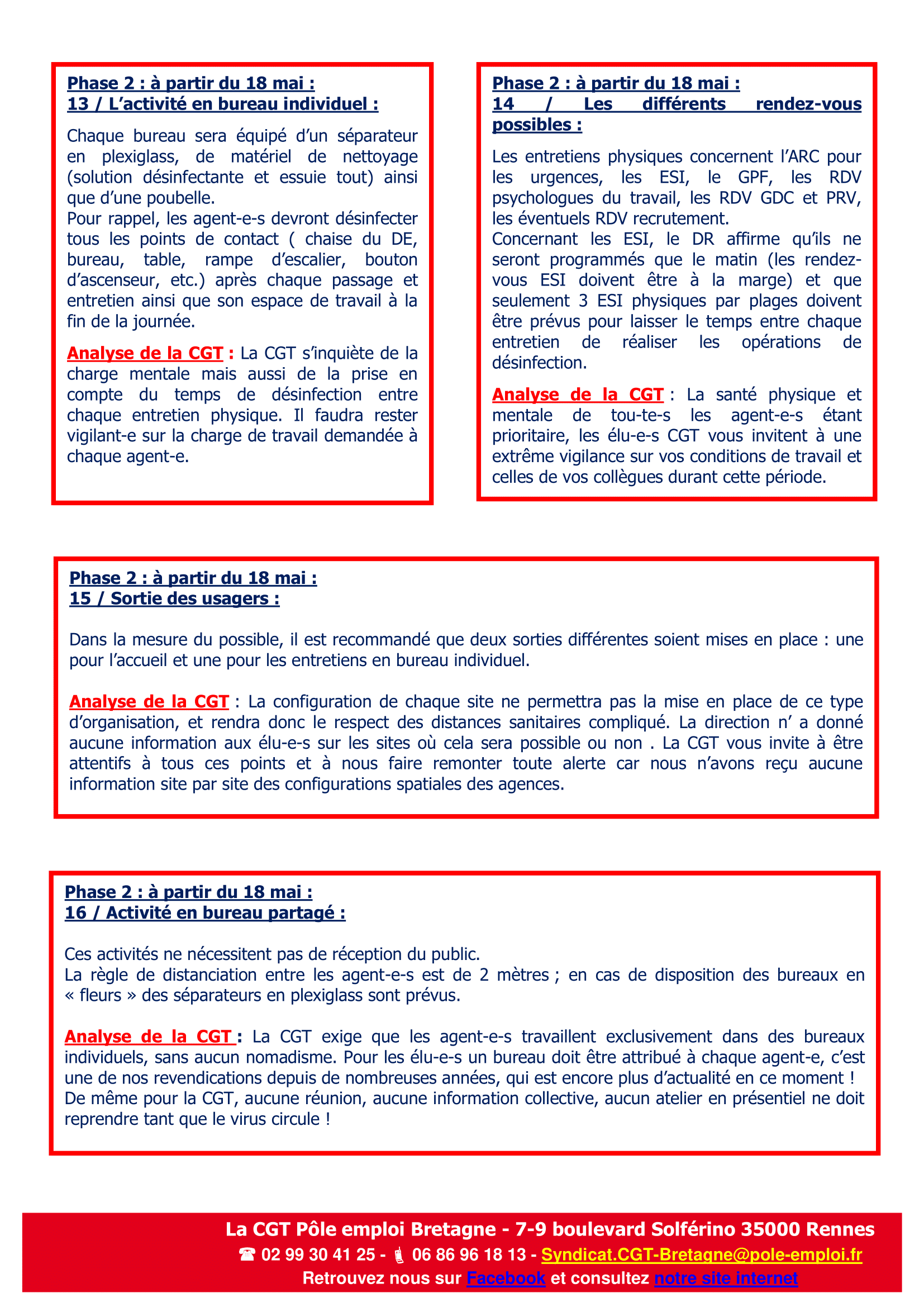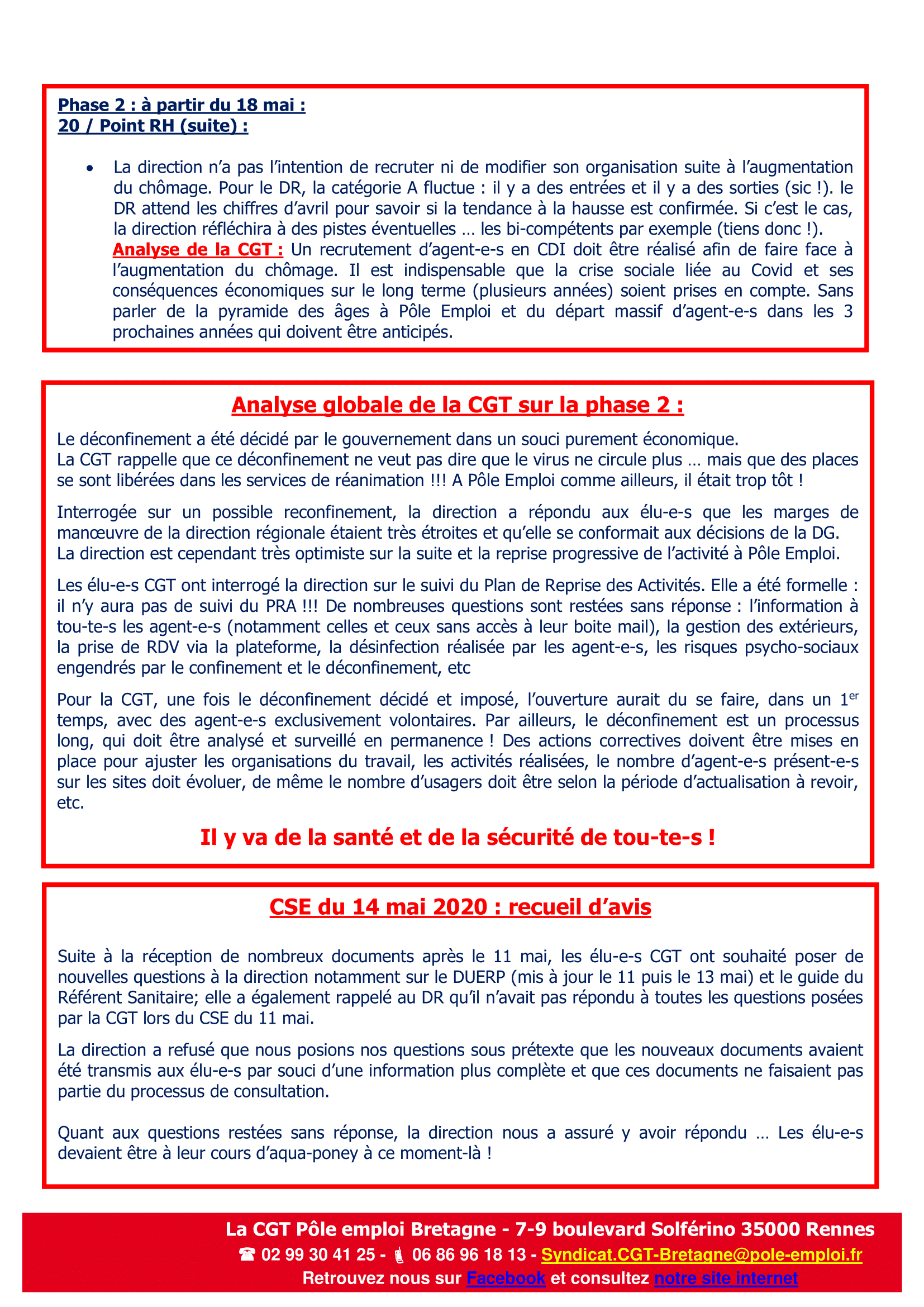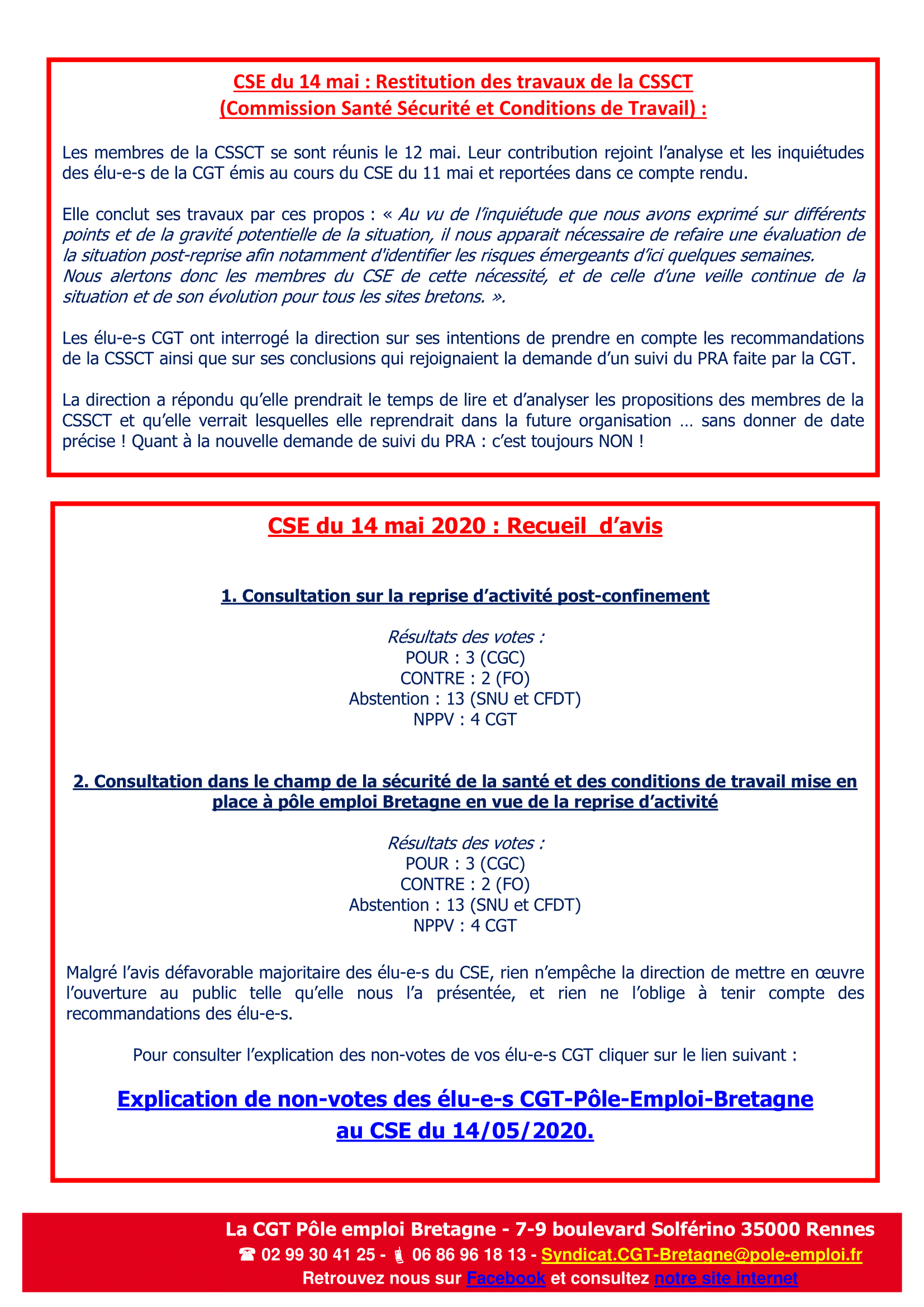L’explosion des chiffres du chômage montre l’urgence d’une autre politique de l’emploi et de la protection sociale.
L’explosion des chiffres du chômage montre l’urgence d’une autre politique de l’emploi et de la protection sociale.
Après une hausse de 7,1 % en mars, le chômage augmente de 22,6 % en avril. On compte désormais plus d’un million de chômeurs supplémentaires (1 065 200), comparé à la période précédant le confinement. La barre des 6 millions de chômeurs est franchie !
Les jeunes sont particulièrement touchés par cette hausse, pour l’instant due essentiellement à l’arrêt des recrutements : +29 % de chômeurs dans la catégorie des moins de 25 ans qui cherchent du travail.
Autre donnée nouvelle : jusqu’à présent le gouvernement se focalisait sur la baisse relative (et en yoyo) de la catégorie A (personnes au chômage total) alors que les catégories B et C croissaient continuellement (les personnes alternant chômage et travail, en très grande majorité sur des contrats précaires, CDD ou CDI à temps partiel, intérimaires, saisonniers, intermittents de toutes sortes). Les travailleuses et travailleurs précaires ont basculé très majoritairement dans le chômage total à cause de la crise, ce qui explique une baisse des catégories B et C et contribue à l’explosion de la catégorie A. Et, nous ne sommes qu’au début des annonces de plans sociaux que la presse révèle.
Constatant que les chômeurs et les précaires sont les premières victimes de la crise de l’emploi liée à la crise sanitaire, la CGT réaffirme la nécessité de mettre en œuvre d’urgence une autre politique de l’emploi : il faut une politique industrielle favorisant la transition écologique et l’indépendance stratégique, à travers notamment les relocalisations, le partage du temps de travail, la confiscation des dividendes pour relancer l’investissement. Il faut des embauches pour faire fonctionner les services publics dans la santé comme dans tous les domaines !
L’emploi des jeunes doit être une priorité absolue, de même que la résorption des inégalités femmes/hommes.
De même, il y a urgence à mettre en place la sécurité sociale professionnelle qui garantira à toutes et tous un revenu de remplacement : cela passe par l’annulation de la réforme scandaleuse de l’assurance chômage et la construction de nouveaux droits dont la prolongation des droits de toutes celles et tous ceux que la crise met au chômage.
C’est le sens de la déclaration commune signée avec un grand nombre d’organisations « Plus jamais ça : un monde à reconstruire » et le sens de la pétition pour l’annulation de la réforme assurance chômage (https://go.lemouvement.ong/petitions/assurancechomage).